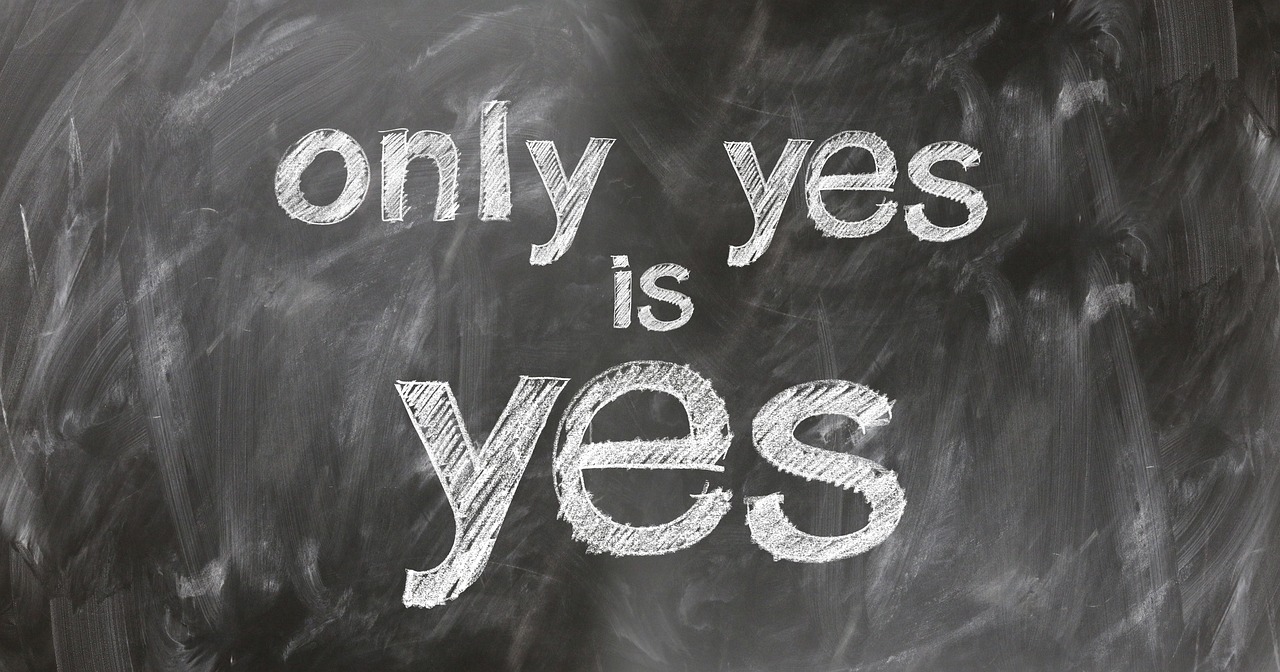Le nouveau droit pénal sexuel en vigueur déjà depuis juillet 2022
LE PRINCIPE
C’est depuis juillet 2022 que le nouveau droit pénal sexuel est d’application. Il comporte plusieurs nouveautés applicables aux faits commis depuis juillet 2022. Les faits commis avant cette date relèvent toujours des anciennes dispositions.
LE CONSENTEMENT AU CŒUR DE LA RELATION SEXUELLE : LE/LA PARTENAIRE DOIT DIRE OUI ET NON PAS SIMPLEMENT NE PAS DIRE NON
L’essentiel de la réforme est d’insister sur le consentement des partenaires à la relation sexuelle.
Le consentement doit être donné librement avant la relation sexuelle et doit porter par exemple sur l’identité du partenaire, sur le type d’acte sexuel, sur l’usage d’un préservatif.
Le « devoir conjugal » n’a pas droit de cité : les relations sexuelles dans le couple doivent aussi être consenties.
Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime : céder n’est pas consentir.
Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel.
Il n’y a pas de consentement lorsque :
- la victime est inconsciente
- la victime est endormie
- la relation sexuelle est intervenue en profitant de la situation vulnérable de la victime (peur, alcool, drogues, handicap,…) qui n’a plus son libre arbitre
- la relation sexuelle est intervenue par violences, menaces, ruse, surprise
- la relation sexuelle est intervenue par l’effet d’une relation d’autorité (ex. : médecin, enseignant, moniteur sportif, chef scout)
- les partenaires sont de la même famille au sens large ou cohabitent (ex. : grand-père, frère, oncle, beau-père, demi-frère), sauf s’ils sont l’un et l’autre majeurs et consentants
- la/le partenaire n’a pas 16 ans (sauf si, à partir de 14 ans, la différence d’âge ne dépasse pas 3 ans) : la majorité sexuelle est donc maintenue à 16 ans mais est parfois abaissée à 14 ans pour prendre en compte les « amours de jeunesse »
LES INFRACTIONS DE MOEURS
L’attentat à la pudeur laisse la place à l’atteinte à l’intégrité sexuelle : l’infraction consiste, en l’absence de consentement de la victime, à accomplir un acte à caractère sexuel sur la victime ou à lui faire exécuter un acte à caractère sexuel (ex. : attouchements sexuels, interaction via webcam)
Le viol reste défini comme consistant en ou se composant d’une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l’aide d’une personne qui n’y consent pas : cette définition large vise la pénétration vaginale, anale, orale, complète ou incomplète, par le sexe, un doigt ou un objet ; elle désigne aussi le viol à distance (ex.: obliger une victime, via une webcam, à se pénétrer)
Le voyeurisme reste interdit : le code pénal interdit d’observer ou d’enregistrer une personne sans son autorisation et à son insu alors qu’elle est dénudée ou qu’elle se livre à une activité sexuelle explicite.
La diffusion non consentie d’images à caractère sexuel reste interdite. Faire suivre à ses amis pareille vidéo est donc interdit.
La victime peut saisir un tribunal en urgence pour que celui-ci donne l’ordre au diffuseur ou au prestataire intermédiaire de retirer immédiatement ces images ou de les rendre inaccessibles, au plus tard dans les 6 heures de la signification du jugement.
La matière des outrages aux mœurs a été modifiée : si l’exhibitionnisme reste interdit, de même que la possession d’images ou de vidéos pédopornographiques, en revanche, seule la production et la diffusion de vidéos ou de productions de contenus à caractère extrêmement pornographique ou extrêmement violent sont interdits. Le visionnage et la détention de vidéos pornographiques ne sont donc pas interdites.
L’approche et la manipulation intentionnelle de mineurs à des fins sexuelles est interdit.
Le proxénétisme ne sera réellement dépénalisé que lorsqu’une nouvelle loi à venir aura donné un statut légal aux travailleuses/travailleurs du sexe. La traite des êtres humains dans le domaine de la prostitution reste sévèrement répréhensible.
Le fait de se prostituer n’est pas une infraction, ce qui n’est pas neuf ; faire de la publicité pour son activité prostitutionnelle n’est autorisé qu’à certaines conditions (le racolage actif en rue reste interdit, pas en vitrine) .
DES PEINES PLUS SEVERES
La tendance générale de la réforme a été de prévoir des peines plus sévères pour sanctionner les infractions de mœurs, conjuguée à la réalité nouvelle que les peines d’emprisonnement sont à présent pour ainsi dire toutes mises à exécution, spécialement lorsque la victime est mineure.
En revanche, des possibilités plus importantes de bénéficier du sursis probatoire à l’exécution de (tout ou partie de) la peine d’emprisonnement ont été généralisées.
De manière générale, les peines alternatives que sont la peine de surveillance électronique (bracelet électronique), la peine de travail et la peine de probation sont exclues du champ d’application du nouveau droit pénal sexuel.
La peine d’interdiction du droit d’exercer une fonction publique est devenue obligatoire et automatique, synonyme de révocation pour les fonctionnaires (ex : enseignant dans le réseau officiel, militaire).
Le tribunal peut imposer des interdictions de résidence à proximité du domicile de la victime ; il peut aussi transmettre la copie de sa décision à l’employeur (ex : une crèche) ou à l’organe disciplinaire du condamné (ex : un puériculteur) qui est professionnellement en contact avec des mineurs.
Adrien MASSET
a.masset@avocat.be
+32 87 67 49 90
Nouveau droit des obligations : focus sur la consécration de la possibilité de remplacer l’entrepreneur défaillant
L’article 5.85 du nouveau Code civil consacre la possibilité de procéder au remplacement de l’entrepreneur défaillant.
L’article 5.85 du nouveau Code civil prévoit trois types de remplacements : le remplacement judiciaire, le remplacement « contractuel » et le remplacement unilatéral.
Le remplacement judiciaire :
Le remplacement judiciaire semble avoir été érigé en tant que principe par le législateur.
En effet, l’article 5.235 du nouveau Code civil indique la marche à suivre pour solliciter le remplacement de l’entrepreneur défaillant.
Le maître d’ouvrage devra demander au juge l’autorisation de procéder au remplacement, en faisant appel à un entrepreneur tiers pour effectuer le travail.
Les frais exposés pour le remplacement seront à charge de l’entrepreneur défaillant et le juge pourra le condamner au paiement d’un montant provisionnel, en attente du décompte final des frais réellement exposés.
L’article 5.235 du nouveau Code civil prévoit également que le travail réalisé par le premier entrepreneur « contrairement à ses obligations » (à titre d’exemple, un travail réalisé de manière contraire aux règles de l’art), pourra être détruit afin de permettre au nouvel entrepreneur de réaliser un travail conforme. Les frais de destructions seront également à charge de l’entrepreneur défaillant.
Le remplacement « contractuel » :
La possibilité de procéder au remplacement peut également avoir été prévue contractuellement. Dans ce cas, le contrat fait la loi des parties et il conviendra de respecter les modalités prévues par le contrat pour procéder au remplacement en cas de défaillance de l’entrepreneur.
Le remplacement unilatéral :
En cas de réelle urgence, empêchant de recourir à une procédure plus longue telle que le remplacement judiciaire, et en l’absence de clause contractuelle prévoyant le remplacement, le maître de l’ouvrage pourra, procéder unilatéralement au remplacement. L’article 5.85 du nouveau Code civil indique que ce type de remplacement ne pourra s’effectuer qu’en cas d’urgence ou d’autres circonstances exceptionnelles. Le législateur spécifie également que lorsque le créancier procède au remplacement unilatéral, il agit à ses risques et périls.
Différentes conditions d’applications doivent d’ailleurs être remplies :
- L’entrepreneur doit avoir été mis en demeure préalablement par le maître d’ouvrage, lui ayant laissé un délai raisonnable afin de s’exécuter. Cette modalité n’est pas explicitement prévue par l’article 3.85 du nouveau Code civil mais constitue un élément essentiel pour démontrer, à postériori, les manquements de l’entrepreneur.[1]
- Le créancier doit avoir pris les mesures utiles pour établir l’inexécution de l’entrepreneur. Cela implique que le maître d’ouvrage doit prouver la défaillance de l’entrepreneur. Prenons le cas d’un travail commencé et mal exécuté et ensuite laissé à l’abandon par l’entrepreneur, la preuve de la défaillance de l’entrepreneur pourrait être démontrée via un constat technique. L’idéal serait que les constats soient posés de manière contradictoire, ce qui n’est que rarement possible face à un entrepreneur défaillant.
- Le créancier doit notifier de manière écrite sa décision de procéder au remplacement, en indiquant de manière claire les différents manquements reprochés à l’entrepreneur ainsi que les circonstances justifiant le remplacement.
Aux vu de ces éléments et afin d’éviter une prise de risque dans le chef du maître d’ouvrage, il est dès lors préférable pour les parties d’insérer dans le contrat une clause prévoyant clairement la faculté de remplacement et dans quelles conditions elle pourra être exercée par le créancier.
Pierre HENRY
p.henry@avocat.be
+32 498 100 633
Laura WALOCHA
laura.walocha@avocat.be
+32 87 29 34 50
[1] Ninane, Y. et Thüngen, R., « L’inexécution du contrat imputable au débiteur » in Jafferali, R. (dir.), Le Livre 5 du Code civil et le nouveau droit des contrats, 1e édition, Bruxelles, Larcier, 2022, p. 219-280
Nouveau droit des obligations : focus sur une des nouveautés, la consécration de la culpa in contrahendo
L’article 5.17 du nouveau Code civil consacre le principe de la responsabilité précontractuelle, qui existait déjà à travers la doctrine et la jurisprudence. Cette dernière permettait en effet déjà à la partie lésée, face à une rupture fautive des négociations dans le chef de la partie adverse, de réclamer une indemnité équivalente à la perte d’une chance.
L’article 5.17 du nouveau Code civil précise et complète ce principe en indiquant en son alinéa 2 que :
« En cas de rupture fautive des négociations, cette responsabilité implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas eu de négociations. Lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, cette responsabilité peut impliquer la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu ».
Sur base de cet alinéa, la personne lésée pourra dès lors réclamer une indemnité lui permettant de se retrouver dans la situation dans laquelle elle aurait été s’il n’y avait pas eu de rupture des négociations.
La grande nouveauté est donc la possibilité d’indemniser, au-delà de la perte de chance, la perte des avantages nets attendus. L’article prévoit cependant des conditions d’application strictes : la partie lésée doit avoir eu la certitude que le contrat serait sans aucun doute conclu, reposant sur une confiance légitime. Les travaux préparatoires précisent que l’indemnisation des avantages nets attendus ne pourra avoir lieu que dans des cas exceptionnels.
Pierre HENRY
p.henry@avocat.be
+32 498 100 633
Laura WALOCHA
laura.walocha@avocat.be
+32 87 29 34 50
Focus sur la grande nouveauté du nouveau droit des obligations : l’introduction de la théorie de l’imprévision en droit belge
L’article 5.74 du nouveau Code civil, qui entrera en vigueur le 1ier janvier 2023, consacre pour la première fois en droit belge la théorie de l’imprévision, réclamée de longue date par la doctrine.
Cet article permettra aux parties de réviser le contrat en cas de survenance de circonstances imprévisibles, non imputables aux parties et postérieures à la conclusion du contrat, bouleversant l’équilibre économique contractuel.
Plusieurs conditions d’applications ont été prévues par le législateur :
- Postériorité : de manière évidente, les circonstances doivent survenir postérieurement à la conclusion du contrat.
- Non imputabilité : les parties ne doivent pas être à l’origine des circonstances survenues, devant être indépendantes de leur volonté.
- Imprévisibilité : Les circonstances doivent être imprévisibles.
Cette condition doit s’apprécier de manière raisonnable, ne s’agissant en effet pas d’une condition d’imprévisibilité absolue. A titre d’exemple, une pandémie mondiale ou une guerre sont donc deux évènements imprévisibles.
La théorie de l’imprévision pourra s’appliquer concernant l’imprévisibilité elle-même mais également face aux effets de cette imprévisibilité. Cela signifie que la théorie de l’imprévision pourra s’appliquer sur les effets de l’évènement imprévisible « initial », étant eux aussi, imprévisibles pour les parties. A titre d’exemple, la fermeture obligatoire des lieux « publics » tels que les entreprises, restaurants, cinémas, etc. en raison de la pandémie de Covid-19 peut être considérée comme un effet imprévisible de la pandémie.[1]
- Pas de prise de risque volontaire : dans l’analyse de l’imprévisibilité, il conviendra de prendre en compte la notion de risque. En effet, si une des parties prend volontairement un risque, les circonstances futures découlant de ce risque ne pourront pas être considérées comme étant imprévisibles.
- Les circonstances doivent bouleverser l’économie du contrat. Cela implique un réel déséquilibre des prestations, une onérosité excessive. La conséquence de ce bouleversement étant que les prestations ne peuvent raisonnablement plus être exigées de la part des parties préjudiciées.[2]
Lorsque ces conditions sont remplies, les parties devront alors renégocier le contrat initialement conclu. Renégocier signifie adapter le contrat, de manière raisonnable, afin qu’il ressemble à ce que les parties auraient pu convenir si elles avaient été informées, dès le départ, du changement de circonstances. La renégociation laisse évidemment place à une marge d’appréciation dans le chef des parties.
En son dernier alinéa, l’article 5.74 du nouveau Code civil prévoit qu’en cas d’échec ou de refus des renégociations, le juge pourra être amené à adapter le contrat, sur demande de l’une ou l’autre des parties :
« En cas de refus ou d’échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixées par le juge. L’action est formée et instruite selon les formes du référé ».
Enfin, il convient d’insister sur le fait que cet article est supplétif. Cela signifie que les parties pourront déroger à l’application de l’article ou le modéliser via une clause contractuelle. Ce qui risque probablement d’arriver…
Pierre HENRY
p.henry@avocat.be
+32 498 100 633
Laura WALOCHA
laura.walocha@avocat.be
+32 87 29 34 50
[1], « Le nouveau droit des obligations », sous la direction de B. KOHL et P. WERY, CUP, Volume 2016, octobre 2022, ANTHEMIS.
[2] Idem.
La nouvelle réforme du droit des biens
Dans le cadre d’une loi du 4 février 2020 a été adopté dans le Code Civil un nouveau Livre 3 intitulé « Les Biens ».
La majorité des dispositions que ce livre contient sont entrées en vigueur le 1er septembre 2021.
Cette réforme du droit des biens a pour but de moderniser certaines dispositions du Code civil en tenant notamment compte de la jurisprudence qui s’est développée au cours des années.
Plusieurs points méritent à cet égard d’être mis en avant :
- La prescription acquisitive immobilière
Mode d’acquisition de la propriété par la possession prolongée d’un bien durant un certain temps, il est désormais explicitement prévu qu’elle puisse être constatée par l’introduction d’une action en justice.
Le délai pour prescrire est également réduit d’office à 10 ans en cas de bonne foi du possesseur, sans qu’un titre juste ne soit requis (acte de vente, testament,…).
- Les troubles de voisinage : consacrés par le Titre 5 du Livre du Code civil intitulé « Relations de voisinage »
Création de la jurisprudence, ce principe est désormais consacré et défini dans le Code civil.
Nouveauté : désormais, en cas de risque grave et manifeste lié à l’immeuble voisin en matière de sécurité, santé ou pollution, vous pourrez intenter une action préventive en justice afin d’empêcher que le risque se réalise.
- Les servitudes
1. Les notions de servitudes continue et discontinue sont supprimées et le terme de servitude apparente est précisé de manière plus claire :
« Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent au titulaire, prudent et raisonnable, d’un droit réel sur le fonds servant, soit par des ouvrages permanents et visibles, soit par une activité régulière et révélée par des traces sur le fonds servant. Les autres servitudes sont non apparentes ».
Ainsi, une servitude de passage devient susceptible de naître par prescription acquisitive si on y trouve des traces comme par exemple, une clôture, des traces de roues de véhicules,… ce qui n’était pas le cas avant.
2. Concernant les servitudes de jours et vues, le nouvel article 3.132 du nouveau livre 3 établit :
« Le propriétaire d’une construction peut réaliser des fenêtres au vitrage transparent, des ouvertures de mur, des balcons, des terrasses ou des ouvrages semblables pour autant qu’il soit placé à 19 décimètres de la limite des parcelles ».
Il s’agit d’une innovation marquante de la loi : plus de distinction entre les vues obliques et droites et plus de recours aux termes de vues, ni de jours avec des restrictions de hauteur, de verre dormant, ou fer maillé.
- Le droit de propriété – plus si absolu : l’article 3.67 du nouveau livre 3 instaure un nouveau principe de tolérance afin de résoudre plus facilement les différends entre propriétaires de fonds voisins
- Si une chose ou un animal se trouve involontairement sur la propriété voisine, le propriétaire de cet immeuble doit le restituer ou permettre que le propriétaire de cette chose ou de cet animal vienne le récupérer.
- Le propriétaire qui a des travaux à effectuer sur sa propriété pourra obtenir le droit d’accéder au terrain du voisin si cela s’avère indispensable (travaux de construction, de réparation ou d’entretien de sa clôture), après notification préalable au propriétaire voisin.
Remarque : ce droit doit être exercé de la manière la moins dommageable pour le voisin qui peut refuser cet accès en cas de motifs légitimes.
- L’intégration de certaines dispositions du Code rural
- Distance des arbres d’au moins 2 mètres : 2 mètres de la limite de propriété, à partir du milieu du tronc de l’arbre.
- Distance pour les autres arbres, arbustes et haies : 50 centimètres de la limite de propriété.
- Si les branches voisines dépassent ou envahissent votre propriété, vous pourrez désormais, de votre propre chef, couper ces branches, après avoir envoyé une mise en demeure recommandée restée sans suite pendant 60 jours.
Attention : vous assumez toutefois le risque des dommages causés aux plantations.
En conclusion, il s’agit d’une réforme importante car si de nombreux principes sont maintenus, voire confirmés, d’autres dispositions opèrent des modifications fondamentales.
Cependant, les implications de certaines d’entre elles doivent encore être balisées par la jurisprudence.
***
N’hésitez pas à nous contacter !
Frédéric LEROY et Violette COLLIN
f.leroy@avocat.be
+32 87 32 15 54
Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales
Une loi du 14 août 2021, publiée au Moniteur Belge le 30 août 2021, durcit la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Elle est entrée en vigueur le 1er février 2022.
Dans le cadre d’une transaction commerciale entre entreprises, les entreprises conviennent le plus souvent d’un délai de paiement (autre que le délai légal de 30 jours civils). Celui-ci ne peut plus excéder 60 jours civils. Une exception peut cependant être prévue dans certains secteurs, par arrêté royal.
La loi ou le contrat peut également prévoir une procédure de vérification ou d’acceptation afin de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat. Ce délai de vérification fait désormais partie intégrante du délai de paiement.
Par ailleurs, le créancier et le débiteur ne peuvent plus fixer contractuellement la date de réception de la facture. Le délai de paiement ne commence à courir qu’à partir de la réception effective de la facture par le débiteur. Il pourrait cependant encore être allongé artificiellement en fixant contractuellement la date de la facture elle-même…
Enfin, en cas de retard de paiement, le montant impayé est de plein droit et sans mise en demeure, majoré d’un intérêt au taux directeur majoré de 8 points (= 8% en 2021). Y déroger contractuellement reste possible (sous réserve de l’abus manifeste). Une indemnité forfaitaire de 40 euros est d’office ajoutée pour les frais de recouvrement encourus par le créancier (sous réserve d’une indemnisation raisonnable pour les autres frais, et de l’indemnité de procédure).
La volonté d’améliorer le comportement des entreprises en matière de paiement est assurément légitime : la crise du coronavirus a incontestablement accentué les difficultés rencontrées par les entreprises, et plus particulièrement les PME, pour obtenir le paiement de leurs factures dans les temps.
De nombreuses petites et moyennes entreprises, tant « débitrices » que « créancières », ont donc été et restent confrontées à des problèmes de liquidités. Ils ne seront malheureusement pas réglés par un simple durcissement des dispositions relatives au retard de paiement…
A cet égard, un dispositif de soutien à la médiation d’entreprise et à la procédure de réorganisation judiciaire a été mis en place par la Région de Bruxelles Capitale ( formulaire de demande disponible sur le site https://becionline.typeform.com/to/HgRp9Qh2?typeform-source=1819.brussels ).
Un dispositif similaire doit impérativement être mis en place très rapidement pour les entreprises en difficultés de la Région wallonne !
Pierre HENRY
p.henry@avocat.be
+32 498 100 633
Sort du compte courant débiteur en cas de faillite
Lorsqu’un dirigeant d’entreprise prélève des fonds appartenant à la société (que ce soit à titre d’avance sur rémunération, pour des dépenses privées ou pour toutes autres dépenses non justifiées), les sommes prélevées sont inscrites à son compte courant.
Outre les conséquences négatives de ces inscriptions pendant la vie de la société (taux d’intérêt des prêts non hypothécaires sans terme convenu particulièrement prohibitif, impact négatif sur l’octroi des crédits bancaires, …), elles représentent un réel danger pour les dirigeants d’entreprise en cas de faillite.
D’un point de vue civil, toute somme inscrite au compte courant débiteur fera l’objet d’une réclamation par le Curateur.
Le dirigeant d’entreprise aura du mal à contester les sommes réclamées alors que la comptabilité constitue un aveu extrajudiciaire dans le chef de la société et, selon une bonne partie de la doctrine, fait preuve des obligations du dirigeant à l’égard de celle-ci.
La situation peut être particulièrement difficile pour le dirigeant d’entreprise ayant reçu des avances sur rémunération alors que les statuts de la société prévoient que son mandat est gratuit sauf décision contraire de l’assemblée générale. Habituellement, l’approbation des comptes annuels dans lesquels figurent ces rémunérations vaut ratification implicite. Dans l’hypothèse où l’exercice comptable n’est toutefois pas clôturé en raison de la faillite, il n’y aura pas de ratification et ces sommes pourront également être réclamées par le Curateur.
Il en sera de même pour le dirigeant qui, étant également associé, s’est octroyé des avances sur dividendes (alors qu’aucun dividende ne sera, en définitive, attribué à la fin de l’exercice).
D’un point de vue pénal, il pourra être considéré – selon les circonstances – que les prélèvements effectués par le dirigeant d’entreprise ont eu pour conséquence que les liquidités de la société ont diminué et que l’équilibre financier de la personne morale a été mis en péril de sorte que ces prélèvements seront considérés comme significativement préjudiciables à la société et à ses créanciers. Si le Tribunal considère que la prévention d’abus de biens sociaux (article 492bis du Code Pénal) est établie, cela débouchera sur une condamnation pénale.
Dans cette hypothèse, il est probable que le Tribunal prononce une mesure de confiscation par équivalent à concurrence des avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction.
Enfin, il arrive que le Tribunal assortisse également la condamnation d’une interdiction professionnelle.
En conclusion, le dirigeant d’entreprise – que l’entreprise soit en difficulté ou non – est invité à être particulièrement prudent quant à l’utilisation du compte courant qui ne doit être utilisé qu’avec parcimonie et non comme un moyen de financement de ses dépenses privées.
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et répondre à toute question ; n’hésitez pas à nous contacter !
Maxine BAIVIER
m.baivier@avocat.be
+32 4 277 03 47
Newsletter spéciale « inondations »
Tout d’abord, nous témoignons de notre plus grande solidarité envers toutes les personnes qui ont été impactées par les intempéries qui ont frappé notre région.
Au vu des nombreuses questions posées, vous trouverez ci-après nos premiers éléments de réponse à propos des assurances et à propos des contrats de bail.
1. ASSURANCES
- Déclaration de sinistre
Si ce n’est déjà fait, il est urgent de prendre contact avec son assurance et/ou avec son courtier.
Il est en effet nécessaire de déclarer officiellement le sinistre à son assurance.
Cela peut se faire en ligne tandis que certaines compagnies ont prévu des documents types.
- Lecture et analyse de votre contrat d’assurance
Il convient de retrouver et de relire votre contrat d’assurance incendie et multirisques habitation.
Pour ce faire, vous pouvez vous faire aider par votre courtier en assurance ou par votre conseiller juridique.
- Preuves
Faites des photos de tous les biens abimés ou détruits ainsi qu’une liste de tous ces objets.
Cela vaut également pour l’immeuble lui-même et il importe de photographier toutes les conséquences de la montée des eaux en ce compris le niveau atteint par l’eau.
Si cela est possible, il peut être conseillé de garder les plus grosses pièces abimées (par exemple frigo, machine à lessiver, …).
Il convient également de conserver précieusement les preuves d’achat de nouveaux biens ainsi que les devis et factures de services.
Nous conseillons donc de préparer un dossier complet et de conserver au maximum toutes les preuves.
- Mesures de sauvegarde
Il vous appartient de prendre toutes les mesures possibles pour sauvegarder votre patrimoine et ne pas aggraver le dommage.
Cela vaut pour les biens meubles mais également pour l’immeuble en lui-même.
Ces démarches de sauvegarde et leur coût pourront être réclamées à l’assureur en fonction de la police d’assurance.
- Expertise
Via votre courtier ou votre assureur, un expert sera sans doute envoyé sur place pour constater les dégâts et chiffrer le dommage.
Il conviendra au préalable de transmettre tout votre dossier de pièces à l’Expert et à l’assurance.
Vous serez bien entendu présent lors de la visite de l’Expert pour pouvoir expliquer jusqu’où l’eau est montée et détailler l’ensemble de votre préjudice.
Le cas échéant, vous pouvez faire appel à un contre-expert.
- Indemnisation
Lorsque vous recevrez une proposition d’indemnisation de l’assureur, il convient de vérifier le tout attentivement et le cas échéant de consulter votre courtier ou votre conseiller juridique.
2. CONTRAT DE BAIL
- Prévenir le bailleur
Vous avez bien entendu informé le propriétaire bailleur de la situation et des dégâts.
Il est toujours utile de garder une trace écrite des différentes démarches (par exemple courriel).
- Vérifier et lire le contrat d’assurance
Le propriétaire-bailleur a sans doute souscrit un contrat d’assurance incendie plus risques connexes qui couvre l’immeuble et éventuellement le chômage locatif (perte des loyers suite aux dégradations).
Le locataire doit également relire son contrat et voir s’il est assuré pour le contenu en plus de sa responsabilité civile locative.
A nouveau, faites-vous aider pour la lecture et l’analyse de vos contrats d’assurances.
- Loyers
L’article 12 du Décret Wallon du 15.03.2018 relatif au bail d’habitation stipule :
« Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances demander ou une diminution de prix, ou la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. »
Si le bien loué est inhabitable et que le locataire doit être relogé, il ne doit naturellement plus payer le loyer et le bail est résilié.
Si le locataire ne sait pas rester dans les lieux momentanément mais souhaite tout de même conserver certains biens sur place, il convient de prendre un arrangement avec le bailleur pour payer par exemple 50 % du loyer. Le maître mot est de négocier avec le bailleur.
Si le bien reste habitable, le locataire peut y rester et devra payer le loyer. Des mesures devront être prises par le locataire et/ou le propriétaire pour permettre une jouissance paisible des lieux.
***
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions ou si vous avez besoin d’assistance.
Les points prédécrits peuvent naturellement être approfondis.
Courage à tous !
Frédéric LEROY
f.leroy@avocat.be
+32 87 32 15 54
Les clauses abusives dans les contrats conclus entre entreprises
Le 1er décembre 2020, est entrée en vigueur la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marchés déloyales entre entreprises.
Régulièrement présentée comme une nouvelle arme pour les PME en position de faiblesse, la loi était très attendue par le secteur.
La présente newsletter se limitera à analyser la problématique des clauses abusives.
Champ d’application
La législation sur les clauses abusives s’applique à tous les contrats entre entreprises – sauf ceux qui concernent les services financiers et les marchés publics – pour peu qu’ils soient conclus, renouvelés ou modifiés après le 1er décembre 2020.
Une obligation de transparence et une interdiction d’abus
Avant tout autre chose, la loi pose un principe général de transparence édicté par l’article VI.91/2 :
« Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat sont écrites, elles doivent être rédigées de manière claire et compréhensible.
Un contrat peut être interprété notamment en fonction des pratiques du marché en relation directe avec celui-ci. »
La loi pose également une interdiction transposée dans l’article VI. 91/6 « tout clause abusive est interdite et nulle ».
La clause abusive est décrite de manière générale à l’article VI.91/3 :
« toute clause d’un contrat conclu entre entreprises est abusive lorsque, à elle seule ou combinée avec une ou plusieurs autres clauses, elle crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties » ;
Ce « déséquilibre manifeste » sera appréhendé selon divers critères d’appréciation : la nature des produits, les circonstances lors de la conclusion du contrat, l’économie générale de ce dernier, les usages commerciaux… Ces critères, fixés par le législateur, pourraient être complétés par la jurisprudence. On note d’ores et déjà que le déséquilibre devant être manifeste, le pouvoir du juge ne sera que marginal.
Le législateur a également adopté deux listes de clauses qu’il considère comme abusives :
- Une liste de quatre clauses réputées abusives de manière irréfragable (liste noire de l’article VI. 91/4) et qui comprend, par exemple, l’interdiction des clauses permettant un droit d’interprétation unilatéral ou faisant renoncer l’une des parties à tous recours ;
Ces clauses sont considérées comme abusives sans qu’il ne soit possible d’apporter la preuve contraire.
- Une liste de huit clauses réputées abusives de manière réfragable (liste grise de l’article VI. 91/5). Cette liste reprend notamment les modifications unilatérales non justifiées, le placement du risque économique sur une partie autre que celle à qui il devrait en principe incomber, etc.
Pour ces clauses, il est possible de démontrer que compte tenu des circonstances ou des caractéristiques du contrat, elles ne doivent pas être considérées comme abusives.
Sanction et conclusion
La loi sanctionne les clauses abusives par la nullité, le contrat restant toutefois contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
Pour éviter cette nullité, il est important pour toutes les entreprises travaillant en B2B de revoir les conditions générales et leurs nouveaux contrats à l’aune de cette nouvelle loi.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller et répondre à toute question ; n’hésitez pas à nous contacter !
Maxine BAIVIER
m.baivier@avocat.be
+32 4 277 03 47
La responsabilité in solidum de l’architecte et de l’entrepreneur : utilité des clauses d’exonération de responsabilité ?
L’architecte et l’entrepreneur sont responsables in solidum lorsqu’un dommage trouve son origine dans leurs fautes concurrentes et que, sans la faute de l’un, la faute de l’autre n’aurait pas suffi à causer le dommage. Chacun a donc l’obligation de réparer l’ensemble du dommage.
Le maître d’ouvrage pourrait dès lors indifféremment choisir de s’adresser à l’architecte ou à l’entrepreneur pour lui réclamer l’entièreté de son dommage, à charge pour celui qui aura indemnisé le maître d’ouvrage de se retourner ensuite contre l’autre intervenant fautif pour lui réclamer sa part.
On trouve toutefois souvent dans les contrats d’architecture et les contrats d’entreprise des clauses d’exonération de la responsabilité in solidum dont l’objectif est de limiter la responsabilité de l’architecte ou de l’entrepreneur à sa part du dommage.
L’architecte ou l’entrepreneur ne devra donc indemniser le maître d’ouvrage qu’à concurrence de sa part de responsabilité et non au-delà.
Ce type de clause est parfaitement valable pour ce qui concerne les vices cachés véniels, à savoir les vices qui ne portent pas atteinte à la solidité du bâtiment, mais en perturbent néanmoins l’utilisation normale et qui ne pouvaient pas être découverts lors de la réception provisoire des travaux par une personne normalement attentive.
En revanche, les clauses d’exonération de la responsabilité in solidum ne sont pas valables pour ce qui concerne la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs, c’est-à-dire la responsabilité du fait des vices graves qui portent atteinte ou sont susceptibles de porter atteinte à la solidité ou la stabilité du bâtiment.
La Cour de cassation s’est à nouveau prononcée sur cette question dans un récent arrêt du 12 février 2021.
Elle a tout d’abord rappelé les règles de la responsabilité décennale des entrepreneurs et architectes : si l’édifice construit, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés.
La Cour de cassation a ensuite confirmé que la responsabilité décennale de l’architecte et de l’entrepreneur pour les vices graves affectant ou mettant en danger la solidité du bâtiment ou de l’un de ses principaux éléments est d’ordre public et ne peut être exclue ou limitée contractuellement.
Une clause limitant cette responsabilité qui tend, en cas de fautes concurrentes de l’architecte et de l’entrepreneur, à limiter leur responsabilité à leur part de dommage est nulle et non avenue, que les travaux aient été acceptés ou non par le maître d’ouvrage.
L’architecte et/ou l’entrepreneur ne peu(ven)t faire appel à une clause du contrat d’architecture ou d’entreprise selon laquelle la responsabilité in solidum avec l’entrepreneur ou l’architecte est exclue. L’architecte et l’entrepreneur seront donc condamnés in solidum au paiement de dommages et intérêts à l’égard du maître d’ouvrage.
En résumé : les clauses d’exonération de responsabilité sont extrêmement utiles pour ce qui concerne les vices cachés véniels, mais ne sont pas valables lorsqu’elles visent à limiter la responsabilité décennale résultant de vices graves mettant en péril la stabilité du bâtiment.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous conseiller et répondre à toute question ; n’hésitez pas à nous contacter !
Charlotte BRANDT
c.brandt@avocat.be
+32 87 32 15 58